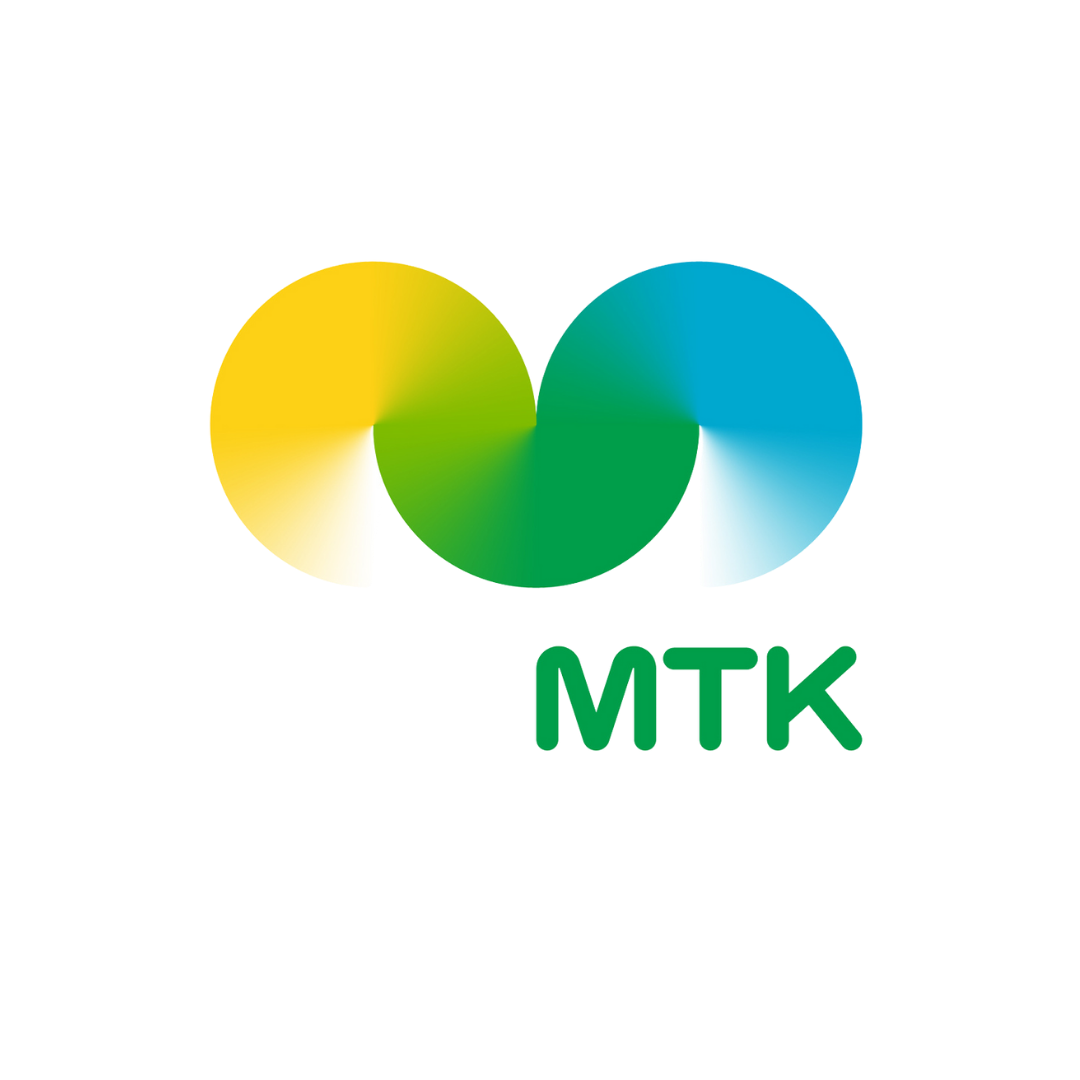Boîte à outils d’AgriCord Construction de la résilience - Partie 1
Questions et réponses
Questions sur la logistique et l'animation des ateliers
L'animateur de chaque groupe est-il un participant ou un co-formateur spécifique (par exemple dans l'exercice World Café)?
Pour certains exercices, vous avez besoin de plus d'animateurs. Pour les sections sur l'évaluation des risques climatiques (3.1. et 3.2.), aucun co-facilitateur spécifique n'est nécessaire, mais chaque groupe doit avoir un preneur de notes qui sait lire et écrire. Toutefois, pour les chaînes d'impact et les options d'adaptation (3.4. et 4.3. World Café), il serait utile de placer des co-facilitateurs ou des preneurs de notes bien informés à chaque station World Café.
Quel devrait être le nombre idéal de participants pour l'ensemble de l'atelier? Et combien de personnes au maximum pour les sous-groupes?
Il y a une certaine flexibilité pour cela. Gérer plus de 50 personnes peut devenir un défi et nécessiter plus de deux co-facilitateurs. Vous devrez adapter la méthode de travail. Le nombre de personnes par sous-groupe serait compris entre 5 et 10.
Comment synthétiser les résultats du groupe? Surtout s'il y a des réponses variées.
Les réponses variées sont bonnes, cela montre des perceptions et des opinions variées provenant de personnes ayant des caractéristiques différentes : sexe, richesse, âge, lieu, etc. Il est important de saisir autant que possible ces liens, de les consolider et de les mentionner dans les tableaux de rapport. Il serait bon de parvenir à un consensus par groupe, même s'il existe des différences d'opinion entre les groupes.
Quelle est la durée idéale de l'atelier avec les agriculteurs?
La durée de 2 jours est nécessaire pour traiter l'ensemble de la chaîne d'impact et la préparation d'un plan d'action. La réduire à une journée ne permet pas de passer par les différentes étapes et de parvenir à un plan d'action. (Conclusion du test effectué en Tanzanie).
Questions sur les concepts clés
Le concept de chaîne d'impact est-il le même que celui de chaîne de valeur?
Non, ce sont des concepts très différents. Alors qu'une chaîne de valeur se concentre sur la production d'un bien commercial et sur toutes les étapes et éléments contextuels, une chaîne d'impact se concentre sur la logique d'un changement de climat et sur la manière dont celui-ci, en différentes étapes logiques, peut avoir un impact sur toutes les activités humaines, les ressources, la production et la qualité de vie.
Les "autres maladies ou insectes des cultures" doivent-ils être en sensibilité ou en impact? Les sécheresses favorisent ces maladies parce que les cultures sont faibles/vulnérables.
Les maladies/insectes entrent normalement dans la catégorie "autres stress", à moins qu'il ne soit clairement démontré qu'ils sont induits par le changement climatique. Si c'est le cas, il s'agit d'un risque climatique. Il peut être difficile de le déterminer, mais l'essentiel est de faire entrer toutes les considérations différentes dans la discussion.
Je suis un peu confus sur les concepts d'adaptation, de prévention, d'atténuation. Exemple: équipement de contrôle des incendies - prévention; plusieurs étangs dans les zones forestières - atténuer l'impact et peut également empêcher la propagation des incendies.
En effet, il y a une confusion générale dans les documents sur le changement climatique sur le mot "atténuation". Il est utilisé dans deux contextes différents:
1. Pour distinguer l'atténuation du changement climatique (réduction des émissions de GES) de l'adaptation au changement climatique. "Atténuation" fait ici référence au ralentissement du phénomène du changement climatique et "adaptation" à celui-ci. L'atténuation se fait par des initiatives qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou les suppriment de l'atmosphère, tandis que l'adaptation fait référence aux initiatives qui permettent de mieux gérer les effets du changement climatique. Certaines initiatives, telles que la plantation d'arbres, permettent de faire les deux en même temps. Les arbres capturent le carbone, mais réduisent également les effets négatifs de l'augmentation des températures sur les cultures en fournissant de l'ombre, par exemple.
2. Dans la gestion des risques climatiques, lorsqu'on parle d'"atténuation de l'impact ou des risques", on entend par là "réduction de l'impact ou des risques".
Nous essayons d'utiliser l'atténuation autant que possible uniquement lorsque nous parlons d'"atténuation du changement climatique" et non pas lorsque nous parlons d'"atténuation des risques et des impacts".
L'adaptation est un ensemble d'actions qui soit préviennent l'impact du climat, soit l'atténuent, soit permettent aux agriculteurs de s'y adapter?
Les mesures d'adaptation peuvent être préventives ou constituer une réaction visant à réduire (atténuer) un impact négatif. L'adaptation vise à modérer ou à éviter les dommages et parfois aussi à exploiter des opportunités bénéfiques. Elle est très large : il peut s'agir d'une action visant à déplacer une activité (par exemple, arrêter l'agriculture dans une région particulièrement sèche) ou à améliorer les caractéristiques d'une production (installation d'un système d'irrigation, par exemple), ou encore à modifier la culture pour qu'elle résiste mieux à la sécheresse. L'augmentation de la capacité d'adaptation (mise en place d'une capacité durable permettant aux agriculteurs de proposer des solutions renouvelées: création d'un service de vulgarisation, d'une ligne de crédit ou d'une assurance climatique, par exemple) relève également de ce vaste concept d'"adaptation".
Je pense que l'accès à l'information par la formation est un moyen d'améliorer la capacité d'adaptation, par exemple en identifiant et en utilisant correctement des variétés de cultures améliorées. Par conséquent, la formation serait-elle une action d'adaptation dans le contexte de l'agriculteur?
Offrir un programme de formation est un moyen de renforcer la capacité d'adaptation, et donc aussi une activité d'adaptation importante.
Le degré de sensibilité dépend de la mesure d'adaptation, même si vous êtes exposé à un danger? Est-ce une bonne compréhension?
La sensibilité est avant tout déterminée par les caractéristiques de la pratique ou de la production agricole, sa qualité. Par exemple, un vieux canal d'irrigation qui traverse une pente instable et abrupte est très sensible aux glissements de terrain. Il est possible d'améliorer cette situation en rénovant le canal et en stabilisant la pente. De cette manière, vous avez réduit sa sensibilité. Ainsi, même si l'exposition au risque climatique reste la même, la sensibilité peut être réduite par une action d'adaptation, dans ce cas la rénovation du canal d'irrigation.
L'adaptation peut être une technologie, des politiques (utilisation des terres), un changement de pratiques, des investissements (infra)?
Oui, c'est un concept très large. Elle implique toute action qui réduit l'exposition au risque climatique, la sensibilité, réduit l'impact ou réduit les facteurs non climatiques et les stress. L'augmentation de la capacité d'adaptation fait également partie de l'"adaptation".
Quelle est la différence entre "déclencheur climatique" et "risque climatique" ?
Le déclencheur est le changement physique du climat et/ou des conditions météorologiques : précipitations, température, fréquence des événements extrêmes ou élévation du niveau de la mer. Un aléa climatique comprend une notion d'impact négatif de ces événements physiques liés au climat. Il fait référence à la manière dont ces déclencheurs se matérialisent dans les exploitations agricoles/régions : inondations, sécheresses, incendies, glissements de terrain. Parfois, un seul déclencheur climatique, tel qu'une tempête destructrice, constitue en soi un danger. Parfois, le danger peut être une combinaison de plusieurs déclencheurs (par exemple, une sécheresse due à la hausse des températures et à des changements dans les précipitations).
Parfois, lorsque nous introduisons de nouveaux concepts, il peut être difficile d'expliquer ces notions scientifiques: le risque existe que l'explication des concepts prenne beaucoup plus de temps et soit plus difficile que prévu/prévu. Le défi consistera à harmoniser et à traduire car les stagiaires risquent de ne pas parler anglais.
C'est en effet l'un des plus grands défis pour les animateurs. Il est donc important que l'animateur se prépare de manière adéquate : transformer les concepts clés en mots "compréhensibles" (danger = danger, exposition = contact, sensibilité = qualité), comme expliqué dans le manuel de l'animateur. L'animateur doit également les traduire dans la ou les langues locales et préparer une bonne façon de transmettre ces concepts.
Comptez-vous les parasites comme des dangers climatiques? En Tanzanie, les agriculteurs estiment que la hausse de la température en provoque un plus grand nombre.
En effet, dans de nombreux cas, le changement climatique crée ou augmente les parasites, les espèces envahissantes, etc. Si les participants veulent considérer un parasite comme un risque climatique important, alors l'animateur peut utiliser la méthodologie de l'outil sur ce risque.
Quelle est la différence entre sensibilité et vulnérabilité?
Conceptuellement, la sensibilité est liée à l'état, aux caractéristiques et aux qualités qui contribuent à la vulnérabilité des composantes des moyens de subsistance (ressources naturelles, infrastructures, activités) et des personnes, ainsi qu'à la capacité d'adaptation (capacité à agir). Ainsi, fondamentalement, la vulnérabilité d'un agriculteur est déterminée par sa sensibilité et sa capacité d'adaptation au changement climatique. Dans le monde réel, ces concepts se recoupent quelque peu.
Il est parfois difficile de décider si une constatation est un facteur de vulnérabilité ou une conséquence. Par exemple, au Sénégal, l'exode rural est exacerbé par de faibles rendements et donc de faibles revenus, mais c'est aussi un facteur de vulnérabilité. L'exemple du Togo en fait également un facteur de vulnérabilité, avec une population vieillissante dans certains villages et des problèmes de main-d'œuvre pour les travaux agricoles.
En effet, le changement climatique est en général un problème complexe. L'aggravation de la sensibilité peut entraîner une augmentation du risque climatique, créant ainsi des failles. Un autre exemple est la déforestation pratiquée par les petits exploitants agricoles : la dégradation des forêts et des sols forestiers en raison de la diminution des précipitations entraîne dans certaines régions une accélération de la déforestation, ce qui conduit à une dégradation accélérée des forêts et des sols, entraînant un taux de déforestation encore plus élevé, etc. L'outil BR, comme presque tous les outils, fait une analyse simplifiée de ces problèmes en tenant compte des commentaires des agriculteurs, et le facilitateur doit en être conscient. En général, il ne faut pas se soucier de saisir toutes les complexités du changement climatique et de ses effets sur l'homme. Le plus important est d'enregistrer les points de vue importants des agriculteurs sur la manière dont ils sont affectés et sur les solutions qu'ils estiment réalisables et efficaces.
Questions sur la méthodologie
Comment sélectionner les moyens de subsistance lorsqu'un aléa touche à tout - par exemple un typhon - affectant les cultures, le bétail, la transformation/fabrication/agro-transformation, les légumes, les produits laitiers, etc.
Une première sélection est basée sur l'importance de la composante des moyens de subsistance : L'importance est classée en utilisant l'exercice participatif de la section 3.2. (Identification des exploitations agricoles et des moyens de subsistance menacés) En général, les exploitations agricoles et les moyens de subsistence. En général, activités agricoles/économiques. Cela peut se faire en s'appuyant sur les opinions des participants, qui constituent le point central du projet. N'oubliez pas que nous travaillons principalement sur l'agriculture et les systèmes alimentaires avec notre organisation d'agriculteurs. Une option consiste à se concentrer sur le produit que le projet soutient et à déterminer quel est le risque le plus grave pour ce produit.
Pour l'examen des événements et des tendances climatiques, examinons-nous uniquement le moment et la fréquence?
Il est utile de discuter des tendances en termes de fréquence/durée mais aussi d'intensité. Un événement, même ponctuel et bref, peut avoir un impact important en raison de son intensité.
Lorsque nous visons à réduire la sensibilité, devons-nous nous concentrer uniquement sur les moyens de subsistance tels que les cultures et le bétail ou également sur d'autres composantes des moyens de subsistance?
Egalement, les activités agricoles spécifiques (l'irrigation, par exemple), les infrastructures, les ressources naturelles. Supposons que vous ayez un pont qui est essentiel pour accéder à votre champ, vous devez alors examiner la sensibilité de ce pont: est-il résistant aux inondations? Survivra-t-il au premier petit typhon qui se présentera?
Que signifient les signes - et + dans le tableau sur la faisabilité des interventions d'adaptation?
Les plus faisables et les moins faisables.
Comment nous, en tant qu'agence agricole, et les agriculteurs eux-mêmes assurent-ils le suivi des plans d'adaptation - suivi de l'adoption des mesures et de leur mise en œuvre, évaluation des incidences - toute méthode à cet égard?
Cette question sera développée dans la partie II de l'outil "Building Resilience", qui se concentre sur les organisations agricoles et les chaînes de valeur. En effet, les organisations agricoles qui veulent établir un plan d'adaptation peuvent devoir réfléchir également à la manière de suivre la mise en œuvre de ce plan.
Apportez-vous des options d'action adaptative déjà promues par certaines organisations sur le terrain, ou des idées réussies provenant d'ailleurs?
Il peut s'agir des deux, voire de pratiques indigènes et ancestrales. Cette partie appartient à FO, et la faisabilité de l'action adaptative dans le contexte local doit être étudiée en premier lieu. Vous risquez de faire courir des risques aux agriculteurs s'ils testent une action et qu'elle ne fonctionne pas. Si vous pouvez faire en sorte que l'essai ne soit pas risqué, il peut être inclus.
Que se passe-t-il si les mesures d'adaptation contribuent, par exemple, à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre? Par exemple, la diversification des moyens de subsistance, on pourrait décider de devenir moins dépendant des cultures arables en investissant davantage dans l'élevage, mais l'élevage contribue aux GES. Par conséquent, l'atténuation devrait également faire partie de cet outil, pour au moins évaluer l'impact des activités d'adaptation sur les émissions de GES? Juste une réflexion.
En effet, parfois, les activités d'adaptation les plus efficaces peuvent en fait augmenter les émissions. Bien que cela ne soit pas toujours facile à établir, il faut en tenir compte lors de la sélection des options d'adaptation. Il s'agit souvent d'actions dites "sans regret". Même si les AA et les OP ont souvent des capacités techniques suffisantes pour identifier ces actions "sans regret", il est bon de les documenter et de les consulter afin de dresser une liste des actions d'adaptation pour vos systèmes agricoles et vos moyens de subsistance.
Dans certains cas, l'élevage peut constituer une option d'adaptation à faible taux d'émission. Cela dépend de la production qu'il remplace, du type de bétail (volaille, porc, petits ruminants, etc.), de l'intensité de l'utilisation des terres associée à cette production (extensive, intensive) et de la manière dont le bétail est nourri (farine de soja, pâturages, foin, etc.). En général, la production de bétail par les petits exploitants est beaucoup moins intensive en GES que la production industrielle/intensive de viande.
Serait-il possible que les agriculteurs ne puissent pas identifier les risques futurs et qu'en tant que facilitateurs, nous les influencions pour les identifier (bien sûr en fonction de la projection des experts/science)?
Il est important pour vous de documenter les risques futurs avant l'atelier. Vous pouvez le faire soit en faisant vous-même la recherche et en la faisant digérer par les participants ; soit en invitant une personne ressource locale en matière de climat (un fonctionnaire, un chercheur, un professeur). En termes de documents, un bon point de départ est la contribution déclarée au niveau national (NDC), qui donne un aperçu des changements futurs, et des références nationales pour ces informations (Institut national de météorologie, par exemple). Il existe une liste de sources d'information sur la section 2.2.3
Je pense que dans l'analyse des risques, nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur les événements passés, mais aussi envisager des interventions qui peuvent avoir modifié le degré de danger et de risque. Par exemple, pour faire face aux inondations (on a construit des ouvrages de protection contre les inondations, on a planté des arbres, on a déplacé des maisons exposées aux risques...)
En effet. Faire des observations dans le domaine des actions d'adaptation qui ont fonctionné (et échoué...) est l'une des premières étapes pour un facilitateur/formateur.
Et pour les typhons? Sera-t-il basé sur une catégorie de typhon dans l'analyse des risques? Les impacts peuvent différer d'une catégorie de typhons à l'autre.
C'est le type d'information que le formateur (vous) doit documenter avant l'atelier. Les typhons et les ouragans constituent un risque climatique très important pour de nombreux pays, et l'adaptation à ces phénomènes est un vaste champ d'action: les systèmes d'alerte précoce, la protection des cultures mais aussi l'amélioration des politiques gouvernementales en matière de filets de sécurité sociale, l'assurance récolte, la promotion de l'épargne familiale sont autant de mesures d'adaptation. Si vous intervenez dans une région ou un pays exposé aux typhons, il est en effet très important de documenter ou d'inviter une personne bien informée à votre atelier
Est-il toujours possible de parvenir à un consensus entre les membres d'un groupe?
Non, il n'est pas toujours possible de parvenir à un consensus entre les membres d'un groupe. Il peut être suffisant de parvenir à un consensus ou à une vision commune du problème ou de la solution au sein de différents groupes plus petits. L'objectif le plus important à cet égard est de saisir les différents points de vue au sein du groupe, ou par sous-groupe (par exemple, les hommes pensent que la production végétale n'est pas si exposée à un risque climatique alors que les femmes pensent qu'elle est très exposée).
Sur la base des projections des scientifiques et des experts, serait-il possible pour l'animateur d'aider les agriculteurs à identifier le ou les futurs aléas lorsque les agriculteurs ne peuvent pas les identifier?
Oui, en effet. Il est important, surtout pour les futurs dangers, que vous le documentiez avant l'atelier. Vous pouvez le faire soit en effectuant vous-même la recherche et en la faisant digérer par les participants, soit en invitant une personne ressource locale en matière de climat (un fonctionnaire, un chercheur, un professeur...).
L'analyse doit-elle se concentrer uniquement sur les moyens de subsistance menacés?
Les moyens de subsistance menacés constituent une vaste catégorie. Vous pouvez donc inclure tout ce qui est important pour vos moyens de subsistance. Par exemple, vous pouvez inclure tout ce qui est important pour vos moyens de subsistance. Les activités - ressources humaines, écosystèmes... - peuvent être pertinentes. En tant qu'animateur, vous devez donc dresser la liste de chaque élément des moyens de subsistance avant l'atelier. Si vous souhaitez en modifier le contenu, faites-le, à condition que tous les éléments importants des moyens d'existence soient couverts par cette liste.
Comment nous, en tant qu'agence agricole, et les agriculteurs eux-mêmes assurent-ils le suivi des plans d'adaptation - suivi de l'adoption des mesures et de leur mise en œuvre, évaluation des impacts - toute méthode à cet égard?
Cette partie passe à la partie suivante de l'outil sur les OA. Les organisations agricoles doivent établir le plan d'adaptation et réfléchir à la manière de le suivre.
Est-il essentiel d'utiliser la méthode de classement dans l'évaluation des risques climatiques?
L'approche proposée aux producteurs consiste à évaluer la probabilité et l'importance du danger à l'aide d'une échelle de classement. Ce n'est pas toujours facile car tout peut paraître important aux producteurs. Cette approche est justifiée afin de générer une discussion sur l'importance relative des éléments et surtout pour voir les éventuelles différences d'opinion entre les sous-groupes de parties prenantes. Tous les producteurs ne sont pas nécessairement touchés de la même manière par un facteur de vulnérabilité. La discussion permettra donc de faire ressortir des préoccupations qui n'ont pas été mises en évidence dans la vision globale ou qui doivent être examinées plus en profondeur par différents sous-groupes. Ce classement facilitera également la définition des priorités dans l'analyse des adaptations possibles.
Qu'en est-il des autres stress, non climatiques? Jusqu'où devons-nous aller dans leur analyse?
Il est important de travailler sur les autres stress s'ils sont très importants aux yeux des producteurs, car ce sera la condition de l'engagement à s'adapter au changement climatique. Les différents stress sont également très complémentaires et les efforts d'adaptation doivent être combinés: par exemple, dans la gestion des ressources naturelles. Si d'autres groupes utilisent la même superficie ou les mêmes ressources naturelles, il est bon de se demander s'il existe des tensions entre les groupes. Cela vous permet d'évaluer un facteur de faisabilité des solutions proposées. Même si les agriculteurs sont d'accord sur les mesures à prendre mais qu'elles ne sont pas acceptables par d'autres groupes utilisant les mêmes ressources, il se peut que l'action d'adaptation prévue ne soit pas réalisable.